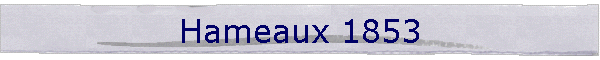
|
|
|
BLANZEY. M. Aug. Digot a lu, en 1850, à la Société d’Archéologie lorraine, une notice sur l’église prieurale de Blanzey, à laquelle j’emprunte quelques détails sur cette intéressante localité : L’emplacement actuel de Blanzey fut, dès la période gallo-romaine, le séjour d’une population qui parait avoir été assez nombreuse. Les terrains qui avoisinent le prieuré, en s’élevant vers le sommet de la colline, sont littéralement couverts de tuiles à rebords, dont l’origine n’est pas douteuse, et de pierres taillées qui ont été employées autrefois dans des constructions. On a même récemment (1850) découvert, au milieu de ces débris, plusieurs fragments de colonnes et un autel quadrilatéral, d’une bonne conservation, qui ne présente malheureusement ni inscription ni bas-relief. On ignore ce que devint cette petite bourgade depuis l’invasion des Barbares jusqu’au XIème siècle. Tout ce que l’on sait, c’est qu’à cette époque le territoire de Blanzey était cultivé et habité, et que ce hameau dépendait, pour le spirituel, de l’église de Dommartin. Le duc de Lorraine Mathieu Ier rappelle, dans un diplôme donné en 1162, qu’un chevalier lorrain, nommé Albert Flohenges, avait abandonné, quelque temps auparavant, aux religieux Prémontrés de l’abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois, près Pont-à-Mousson, un fief (quoddam feodum) situe sur les territoires de Blanzey et de Bouxières. On ignore la date de cette première donation ; mais, comme Mathieu n’a commencé à régner qu’en 1139, elle ne peut être antérieure à cette époque. Par un acte, que D. Calmet place à l’année 1177, la duchesse Berthe, veuve de Mathieu Ier et régente pendant la minorité ou l’absence de son fils Simon II, confirme une donation faite à l’abbaye de Sainte-Marie par elle et par le duc Mathieu, donation comprenant l’alleu de Blanzey, avec tous les serfs qui étaient attachés à la culture, tels que l’avaient possédé auparavant Simon Ier et Thierry, père et aïeul de Mathieu. Ce dernier et Berthe avaient abandonné cet alleu, sans aucune réserve, et libre de toute charge et servitude, notamment de l’obligation de recevoir et nourrir les chasseurs du prince, qui avaient, dit la charte, l’habitude de loger quelquefois dans ce lieu avec leurs chiens. On voit, par l’examen des chartes précédemment rappelées, que Blanzey n’était pas, comme l’a dit le P. Benoît Picart dans son Pouillé du diocèse de Toul,, le chinier des chiens de chasse des ducs de Lorraine, mais simplement un hameau, dans lequel se trouvait une villa faisant partie du domaine ducal. Une bulle du pape Lucius III, de l’année 1181, démontre que cette villa ou cet alleu était loin d’appartenir en entier aux ducs de Lorraine, puisqu’il y est dit qu’une partie du domaine en question avait été donnée aux Prémontrés de Sainte-Marie par Hugues, abbé de Saint-Epvre de Toul, et par les religieux de cette abbaye, moyennant un cens de six sous toulois, payable tous les ans le jour de la fête des Saints-Innocents. Enfin, la même bulle constate que l’église de Blanzey existait dès la seconde moitié du XIIème siècle, et que l’abbesse et le chapitre de Bouxières, à qui elle appartenait, l’avaient abandonnée aux Prémontrés de Sainte-Marie, avec toutes ses dépendances et ses revenus en vignes, terres, prés, dîmes, oblations et aumônes, à charge par les religieux de payer tous les ans, à la Saint-Martin, un cens de trois resaux de blé et de trois resaux de seigle; et que Fleuri, évêque de Toul, et Hugues Leroux (Rufus), archidiacre de cette église, à qui ce cens avait été cédé, en avaient fait la remise aux Prémontrés. Cette dernière circonstance prouve que l’abandon de l’église de Blanzey fut une des premières donations faites à l’abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois, puisque l’évêque de Toul Henri de Lorraine est mort en 1167. Plus tard, en 1180, Henri Ier, comte de Bar, se préparant à partir pour la Palestine, donne une garantie aux religieux de Sainte-Marie contre toutes les exactions que ses officiers, habitant la partie d’Amance qui était sa propriété, avaient coutume de commettre à Blanzey, et autorise les religieux à leur refuser le blé, le vin ou les corvées de labourage que ces officiers exigeaient autrefois. Il accorde, de plus, aux religieux sa protection pour leur domaine de Blanzey, et leur concède le droit de faire paître leurs troupeaux tant dans les plaines que sur les montagnes, tant dans les champs que dans les forêts, et de prendre le bois mort, et cette concession s’étend à tout son alleu. Henri ajoute que, dans le cas où les troupeaux auraient commis quelques dégâts, soit dans les terres cultivées, soit dans les prairies, les religieux se borneront à réparer le dommage, mais ne seront condamnés à aucune amende. Il résulte de tous ces titres que, vers l’année 1189, le prieuré de Blanzey n’existait pas encore, et que ce domaine était une simple dépendance rurale de l’abbaye de Sainte-Marie ; mais, selon toutes les probabilités, la fondation de ce prieuré est de peu de temps postérieure à la bulle du pape Lucius III ; on doit par conséquent rapporter cette fondation aux quinze dernières années du XIIème siècle. Des donations nouvelles vinrent, pendant le XIIIème siècle, augmenter le domaine de Blanzey. En 1280, Ferry III, duc de Lorraine, voulant réparer les dommages qu’il avait causés à l’abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois, céda aux religieux plusieurs terrains qui dépendaient de Blanzey ; il leur en donna plus tard encore quelques autres, au moment où il se préparait à partir pour faire la guerre aux Infidèles. Quelques années après, en 1283, le prieuré reçut en don des vignes situées au-dessous du monastère, et, en 1286, Ferry III confirma cette donation et toutes les autres, à la demande de Thierry, abbé de Sainte-Marie-aux-Bois. A une époque qui nous est inconnue, le prieuré fut réuni à la mense abbatiale de Sainte-Marie-aux-Bois, et on cessa par conséquent d’y entretenir une communauté de religieux. Au commencement du XVIIIème siècle, le revenu était évalué à 3,000 francs. Il y avait alors un ou deux religieux de l’abbaye de Sainte-Marie pour desservir la paroisse de Moulin et administrer la ferme de Blanzey. Cette dernière était une haute justice et avait un ban séparé ; les Prémontrés y avaient des officiers qui dépendaient du bailliage de Nancy. (E. T.) Le prieuré de Blanzey fat vendu, comme bien national, au moment de la révolution, et divisé entre plusieurs propriétaires ; mais, malgré les dégradations de toute nature qu’il a subies, il présente encore l’aspect d’une maison religieuse. L’église passa aussi en différentes mains ; il y a quelques années, elle était partagée en deux ou trois personnes, et l’une d’entr’elles avait laissé transformer la nef en cabaret. Cet état de choses a heureusement cessé. Aujourd’hui l’église entière est rendue au culte, à l’exception toutefois de la crypte, ou chapelle souterraine, qui sert provisoirement de bougerie. L’église de Blanzey, placée sous l’invocation de sainte Agathe, rappelle le style en usage pendant la seconde moitié du XIIe siècle ; c’est, autant que nous pouvons le savoir, vers l’année 1160 que l’église fut cédée par l’abbaye de Bouxières aux Prémontrés de Sainte-Marie-aux-Bois ; nous sommes porté à croire que l’église actuelle est postérieure à cette cession, et que ces religieux, au moment où ils établirent un prieuré dans leurs nouvelles possessions, firent reconstruire l’église, qui, probablement, tombait en ruines. Ce petit édifice fournit donc un spécimen assez complet de l’architecture religieuse on Lorraine pendant la période de transition. Cette église ne possède plus que deux débris de son ancien mobilier : le premier est la tête d’une statue, dont les dimensions sont exiguës, mais le caractère admirable ; le second est une inscription tumulaire, du commencement du XVIIème siècle, gravée au milieu d’un cartouche, et dont l’exécution est assez satisfaisante. Voici cette inscription « CY DEVANT REPOSE LE SIEVR D’AMIC « DE VAVBECOVRT ESCVYER LEQ AYANT « VESCV AVEC CANDEVR ET PROBITE DÉ « CEDA LE 4e DE MARS 1616 AAGÉ DE 36 « ANS. PRIEZ DIEV QU’IL LUY DONNE HEV “REVSE RESVRRECTION. AMEN. « DAMOISELLE CLAVDE HVMBERT SA VEFVE « A SON CHER. ESPOVX A FAICT POSER « CESTE INSCRIPTION POVR MEMOIRE. » ECUELLE. J’ai rapporté, à l’article Bouxières-aux-Chênes, plusieurs titres qui concernent le hameau d’Ecuelle, dépendant de cette commune ; je me borne à y renvoyer. En 1619, les chanoines du chapitre Saint-Georges de Nancy s’étant plaints de ce que le chapelain d’Ecuelle s’était permis d’ouvrir deux portes à la chapelle dudit lieu, et de prendre une cloche pour appeler le peuple au service divin, un décret de l’évêque de Toul, du 12 avril de cette aunée, défendit au chapelain de faire sonner la messe Les dimanches et fêtes, voulant que les malades seuls eussent le droit d’y assister. On lit dans l’Etat du temporel des paroisses (1712) : « Le village d’Ecuelle est de la même seigneurie et juridiction que Bouxières. Il y a une chapelle qui sert de secours a cette paroisse, et où le curé de celle-ci dit la messe les dimanche et fêtes, excepté aux cinq fêtes solennelles de l’année, auxquelles les habitants doivent aller à la paroisse. De cette chapelle dépend un bois, dit de Saint-Etienne, dont le produit est affecté à ses besoins et à sa décoration. Il y a une fondation à l’ermitage qui est au haut du Mont d’Ecuelle ; elle est de 12 francs, qui se paient par le sieur de Tillon (seigneur de Bouxières). » La chapelle d’Ecuelle, dont la nef a été rebâtie par les habitants en 1738, est dédiée à saint Etienne; elle renferme une cloche assez curieuse, et qui remonte au commencement du XVIème siècle, dans laquelle sont incrustées plusieurs pièces en argent de cette époque. LÉOPOLDVALDT. Cette cense, construite eu 1716, par Nicolas-Bernard Raulin, conseiller d’Etat et en la Chambre des Comptes de Lorraine, fut acquise, le 14 janvier 1760, par Joseph-Ignace Lambert de Ballyhier, curé de Bioncourt, dont le frère, Joseph-Augustin Lambert, en était propriétaire en 1776, et en fit ses foi et hommage cette année. Cette seigneurie consistait en haute, moyenne et basse justice, en 150 jours de terre et environ 18 fauchées de prés. Un arrêt du Conseil, du 20 novembre 1756, accorda le droit de vaine pâture pour le troupeau de bêtes rouges et chevaux de la terre de Léopoldvaldt dans les taillis défensables des bois du Roi. (Notes Dupont.) MOULINS , l’un des hameaux qui composent la commune de Bouxières-aux-Chênes ; il y a 53 maisons, 60 ménages et 221 habitants. Ce hameau était autrefois, non seulement un village, mais encore une paroisse distincte de celle de Bouxières ; on lit, à ce sujet, dans l’Etat du temporel des paroisses (1712) : « Moulins est un village dont la communauté est composée de 24 habitants et 2 ou 5 veuves. S A R. (le duc) en est seigneur haut justicier, moyen et bas. Ce village dépend de la juridiction et prévôté d’Amance ; les appels vont au bailliage de Nancy. L’église paroissiale de Moulins est à Blanzey’. Le patronage de la cure appartient aux religieux de Sainte-Marie-au-Bois de Pont-à-Mousson, lesquels y mettent un vicaire perpétuel qui prend ses institutions de l’Ordinaire. « Le 21 janvier 1625, demoiselle Richard a donné une rente de dix francs à la confrérie du Rosaire Frère Mengin Lopin, vivant religieux prémontré à Blanzey, a donné un tonneau de vin contenant sept mesures, à prendre sur un demi-jour de vigne au ban de Moulins, et payable entre les mains du chatelier (marguillier), lequel, avec le maire, doit le conduire à l’église pour en faire la distribution ; ils ont, pour ce, chacun deux quartes, le curé deux, les communiants de Pâques deux ; il y en a deux pour laver les autels au Jeudi-Saint ; le reste se distribue aux paroissiens. Cette fondation est du 29 avril 1577. « A l’égard du village de Moulins, on tient qu’il porte ce nom parce qu’il avait autrefois quatre. moulins en ce lieu « Il y a une petite chapelle qui appartient aux Jésuites du collège de Nancy, à qui elle a été donnée par le sieur de Maimbourg. » (Cette chapelle dépendait sans doute de la maison que Georges Maimbourg, échevin de Nancy, possédait à Moulins, et qui avait été affranchie le dernier mars 1623. (T. C. Amance.) Cette chapelle, qui existe encore, a pour patron saint Hilaire. |
|
Vous êtes
le Ce site est un site privé, indépendant des communes et groupements cités. |