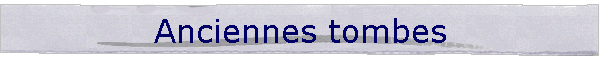
|
|
Anciennes tombes.Les monuments funéraires qui existent dans l’église d’Amance consistent tous en pierres tombales, à l’exception de celui de Charles-Antoine de Vallée (§ 9), qui date de 1830 et provient d’un ancien cimetière ; nous consacrerons un paragraphe à chacun des principaux et réunirons à la fin les épitaphes qui n’offrent plus que des vestiges insuffisants pour permettre de déterminer leur destination exacte. Ainsi que nous l’avons dit plus haut, la plupart de ces dalles sont fort détériorées et l’on ne peut rien affirmer touchant leur emplacement primitif. 1. Agnès (?) femme de Jean Gerlet.1483. La pierre tombale sur laquelle nous trouvons la plus ancienne date, se voit vers le milieu de la nef, du côté de l’épître. Le centre est nu ou fruste ; sur les quatre côtés, on lit, en caractères gothiques Ci git honorable || …………………jadis femme.. Jean Gerlet en son vivant || receveur d amance Cui || trespassa le xv jour de septembre M iiie iiiixx et trois C’est-à-dire: Ci gît honorable N., jadis femme de Jean Gerlet, en son vivant –receveur d’Amance, qui trépassa le 15 jour de septembre 1483. Les deux dernières lettres de receveur sont remplacées par l’abréviation en forme de 3 ; le c de cui. pour qui. ressemble à un G gothique; la conjonction et est figurée par le signe en forme de z allongé, barré au milieu. Les personnages mentionnés dans cette épitaphe sont probablement les parents de Jean Gerlet ([1]), anobli en 1500 qui fit tant de bien à l’église d’Amance. Dans son Nobiliaire, Dom Pelletier a consacré à ce dernier l’article suivant : « Gerlet (Jean), natif d’Amance, maître de la chambre aux deniers de Lorraine, fut annobli par lettres de René II, expédiées au mois de décembre 1500. Porte d’or, à la fasce de gueules chargée en cœur d’un alérion d’argent; et pour cimier un bras armé tenant en sa main un dard qui part d’une nuée d’azur aux deux ailes d’or, lambeaux de même et de gueules. Fol. 19, régist. 1506 et 1510 « JEAN GERLET devint président des comptes de Lorraine, et épousa Catherine Warin, veuve de Mengin Schoel, dit de Saulxures, seigneur de Dommartin-sous-Amance, grand fauconnier de Lorraine, et fille d’Antoine Warin dit de Clemery, seigneur dudit lieu, et de Claude de Revigny : Catherine Warin étoit morte le 8 janvier 1544, que Mengette Colart, veuve de Didier Bertrand, René Warin. seigneur de Clemery, et Antoine de Saulxures, transigèrent sur sa succession nobiliaire.» Les armoiries de Jean Gerlet furent évidemment inspirées par celles de sa femme, dont le père, anobli en 1474, portait : d’argent, au chef d’azur, chargé d’un alérion d’argent; il y a simplement modification de deux émaux et abaissement du chef au milieu de l’écu, en manière de fasce. Dans la suite, le chef des Warin s’est souvent transformé eu un coupé et, d’après quelques auteurs, les émaux auraient varié. Cette famille abandonna, du reste, son nom primitif pour ne plus porter que celui de Clémery; elle contracta des alliances avec plusieurs anciennes maisons et devint très puissante. Husson-1’Escossois lui a consacré un article dans son Simple crayon, par où l’on voit qu’il y aurait erreur à regarder cet ouvrage, si recherché, comme affecté spécialement à l’ancienne chevalerie. Peut-être y a-t-il lieu de rapprocher ces armoiries de celles de Christophe LOMBART dit HUSSON, anobli en 1617; entre autres considérations, les lettres portent « qu’il est entré par mariage en alliance de familles nobles et honorables, » etc; l’écu de ses armoiries était: d’azur, à la fasce ondée d’or, chargée d’une aiglette éploïée ([2]) de sable, et accompagnée de trois fleurs de lis d’argent, deux en chef et une en pointe ([3]).» Mais il y a lieu surtout de faire remarquer leur entière similitude, dont on ne voit pas le motif, avec les armes de Nicolas Du puis, peintre, originaire de Pont-à-Mousson, anobli en 1706 ([4]). La citation suivante se rapporte, sans doute, aux personnages mentionnés dans l’épitaphe et nous donne, croyons-nous, le prénom de la défunte: « Barbe de Fénétrange, comtesse de Moers et de Saverne, ascence, le 23 juillet 1481, une masure avec ses usuaires. séant au bourg d’Amance, à Jean Gerlet, échevin d’Amance, et à Agnès, sa femme ([5]). » La table de l’inventaire Dufourny mentionne les actes suivants qui se rattachent, — sauf un, sans doute, - à Jean Gerlet, anobli en 1500; on aimera peut-être à on retrouver ici l’indication. « GERLET d’Amance (Jean, noble homme, maître en la chambre des deniers du Roi de Sicile, commissaire en 1500. T. 3, p 585-586. — En 1502, T. X, partie II, p. 134- 137. T. 6, p 312. — Trésorier général de Lorraine, en 1508. T. 6, p. 3. « GERLET (Jean), d’Amance, gouverneur des salines de Salone en 1503. T. 9, p601. « GERLET (Jean), secrétaire et chambellan des ducs de Lorraine, achette le bois de Brin en 1504. T. 3, p. 346. Feu Jean Gerlet, président des comptes de Lorraine; sa veuve, Catherine Varin, cède à Claude Gerlet, chanoine de Toul, une rente, en 1528. T. X, p. 138. — La même veuve était morte en 1539. T. 3, p. 849 On a vu plus haut « Claude Gerlet, chantre et chanoine de la cathédrale de Toul, et curé d’Amance », fonder en 1529 la chapelle dite de la Passion. Il était sans doute frère de Jean, l’anobli, dont il fut l’un des exécuteurs testamentaires. En vertu de ce testament fut fondée la chapelle de saint Jean-Baptiste et de sainte Catherine, les patrons du défunt et de sa femme. On parait distinguer une chapelle particulière en l’honneur de sainte Catherine, que l’on croyait fondée par une Catherine Gerlet. Ne s’agirait-il pas plutôt de la femme de Jean Gerlet, Catherine Warin ? Depuis quelques années, nous avons recueilli d’autres renseignements sur Jean Gerlet ; mais ils allongeraient trop cet article et ne sont point nécessaires ici. 2. Jeanne Sauvage (?) femme de Thomas Bastien (?)1560. La tombe qui suit, placée clans lu net du côté de l’évangile, est fort détériorée. Nous y avons déchiffré, sur les bords: Cy GIST NOBLE FEMME || MARIHI (sic) SAWAIGE QUI FUT FEME (martelé) ... -. qui trespassa de ce|| SIECLE LE XX (?) DE MAY MIL VE Lx. PRIEZ DIEU POUR ELLE On voit aussi les restes d’un écu en losange, parti, au 1er lisse ou fruste, au 2 à une trompe de chasse surmontée d’une flèche inclinée en bande. Ce parti convient bien aux armes de la famille Sauvage; la défunte ne serait-elle pas « Jeanne Sauvage », femme de « Thomas Bastien » , et mère de «Suzanne Bastien , qui épousa Jean Dattel, d’Amance, et dont le nom reviendra plus loin. Jeanne était apparemment fille de l’anobli que Dom Pelletier rappelle dans l’article suivant : « Sauvage Nico1as, capitaine gruyer et receveur de Boulay, dont le grand-père, nommé François Sauvage, résident à Nomenv, avoit été annobli en 1528 par le cardinal de Lorraine, évêque de Metz, fut annobli par lettres du grand duc Charles, données à Nancy le 20 avril 1581. Porte d’azur, à la trompe d’or, surmontée d’un fer de lance d’argent mis en bar (sic), au chef d’or ; et pour cimier un homme sauvage au naturel naissant, revêtu et chargé de poil d’or, tenant de la dextre un dard ferré et empenné d’argent, emmanché d’azur. Fol. 183, registre 1582. Les lettres de S.-A. portant mandementt aux gens de ses comptes de Lorraine d’entériner celles de noblesse dudit Nicolas Sauvage, sont du même jour et de la même année. Layette cottée annobliss. num. 203 »
3. Familles Jacquot, Baudin, etc.1580. Une grande pierre tombale, enlevée de l’avant-chœur, offre à la partie supérieure trois écussons, désignant un mari et ses deux femmes Le premier a, en effet, la forme masculine ; malheureusement, il est entièrement fruste. Des deux suivants, en losange, l’un montre un parti où il semble qu’on distingue, au 1er, un lion, au 2e, trois petits objets allongés, rangés en fasce ; l’autre présente les armes de la famille Baudin, c’est-à-dire une hamade[i], accompagnée de trois losanges. Sur les bords, est inscrit, en minuscule gothique: Cy gist nobfe femme eret que fut femme a ~ noble ,( conivinct jacquot receveur damance ... aquelle décéda de ce siècle le ii de juillet 153.. priez dieu pour elle. Puis, au milieu, au-dessous des écussons, on lit: Cy GISENT AVSSI LEDIT noble HOMME NICOLas JACQVOT. RECEPVEVR ET prevost DAMÃCE QVI DECEDA LE IXe lOVR DE NOVEMBRE 1580 ET NOBLE FEMME DION BAULDIN SA SECÕDE FEM ME LAQVELLE TRESPASSA LE XXIIe IOVR DE DECEMBRE SUYVANT. PRIES DIEV POVR LEVRS AMES Dom Pelletier mentionne cinq familles nobles appelées Jacquot, mais nous ne savons à laquelle rattacher le personnage cité dans l’épitaphe; nous ne pouvons, non plus, rien dire de la première femme. Quant à la seconde, il est probable qu’elle était fille de l’anobli à qui Dom Pelletier a consacré l’article suivant : « Baudin ([6]), dit de Salone (Mathieu), gouverneur de la saline de Châteausalin, fut annobli par le duc Antoine le 28 octobre 1542 Porte d’azur, à une hamade d’or en fasce, accompagnée de trois macles de même, deux en chef et une en pointe; l’écu surmonté d’un armet morné, orné de son bourlet, et d’un lambrequin aux métail et couleur de l’écu. « MATHIEU BAUDIN fut père de Jean, qui épousa Cath. Falquestain, dont il eut Charles Baudin, châtelain de Château-Brehain, qui épousa Barbe Sport, de laquelle il eut Christrophe de Salone, écuyer, qui prit alliance avec Dieudonnée Le Changeur. » 4. Familles Mory, de Nay, Brigeot.1602-1611. Voici encore une grande pierre tombale récemment. extraite du pavé de l’avant-chœur. Elle porte, dans le haut, deux écus accolés; l’un, à un chevron, est surmonté d’un armet morné de forme ancienne, avec cimier peu distinct: il désigne le mari ; l’autre, ne laissant plus voir qu’un parti, appartient à la femme. Ce sont, comme on le verra, les armoiries d’André Brigeot et de Françoise de Nay. On lit sur les quatre côtés : CY GIST damoiselle (?) ANNE DE MO || RY VIVÃTE FEME A NOBLE ANTHO1NE DE NAY RECEVEur du DOMAINE DE Son Altesse. (?) A NÃCY LAQ. || DECEDA AV LIEV DAMÃCE LE 4 MARS -1602 PRIE DIEV PO SON AME. Les deux dernières lettres de domaine sont accolées. ainsi que les deux lettres de l’article au ; le 2 de 1602 est on forme de Z. Dans le milieu, au-dessous des armoiries, est gravé: AVSSI GIST NOble FranCOIse DE NAY VIVAnte FEme A NOBle ANDRE BRIGEOT CAPITAINE PREVOST D’AMÃCE COTRE ROLLEVR ([7]) ES. RECEPTE ET. gruerie[ii] DVDICT LIEU LAQVELLE. DECEDA LE 21 DECEMBRE1611 AAGEE. DE 14 ANS DEUX MOIS PRIES DIEV POVR SO ÂME Les deux lettres de AVSSI sont accolées. Antoine de Nay ([8]), dont il ne faut pas confondre la famille avec celle des de Nay, comtes romains et de Réchicourt, avait été anobli en 1578, et ne paraît pas avoir laissé de postérité masculine. Dom Pelletier lui a consacré l’article suivant : « Nay (Antoine de), receveur de la châtellenie de Nancy, fut annobli par lettres du grand duc Charles, données en ladite Ville le 12 août 1578. Porte d’azur, au croissant montant d’argent, accompagné de trois rouës d’or posées deux et une ; et pour cimier un croissant d’argent surmonté d’un homme armé et naissant, tenant de la dextre sur son épaule une lance férée d’argent, le bâton d’or. au pannonceau d’azur, et de la sénestre portant une targue d’azur à une rouë d’or. Trésor des chartres, fol.309, regist.1577, 1578. « ANTOINE DE NAY avait épousé noble Anne de Mory, inhumée à Amance le 4 mars 1602, et dont il avoit eu Françoise de Nay, qui épousa noble André Brigeot, capitaine-prévôt de ladite ville, et laquelle y décéda le 21 décembre -1661 (lire1611), âgée de quatorze ans. » Il y a lieu de croire bien qu’on ne trouve pas son nom dans le Nobiliaire, qu’Anne de Mory ([9]) était fille de Jacques de Mory, de Tonnoy, anobli en 1587 ([10]) qui épousa Jeanne Didelot. L’origine de Jacques de Mory n’est pas très bien élucidée[11]; il y a lieu de faire remarquer l’analogie de ses armes avec celles de Menqin Schouel dit de Saulxures (village situé près de Nancy et non loin d’Amance), où il était né. Ce dernier, anobli en 1503, portait, croit-on :-Parti, bandé et contrebandé d’or et de sable; et Jacques de Mory: Parti, bandé et contrebandé ondé d’or et d’azur. On a vu plus haut que Catherine Warin de Clémery, femme de Jean Gerlet, avait été auparavant mariée à ce même Mengin Schouel de Saulxures ; ainsi, des liens de parenté devaient exister entre toutes ces familles, à cause des enfants nés de ces différentes alliances et de mariages que leur postérité avait contractés dans la suite. Cependant il se pourrait aussi qu’Anne de Mory descendit de Jean, anobli en 1555, qui portait De gueules, au chevron d’argent, accompagné de trois sphères d’or cimier. « une tête de nègre en naturel pannachée desdits métaux et couleurs ([12]) » André Brigeot, gendre d’Anne de Mory, reçut les mêmes armoiries, ainsi qu’on va le voir : il serait donc permis de supposer qu’il les emprunta, non pas à sa femme directement, parce que la famille s’y sera sans doute opposée, mais à la mère de sa femme, dont les parents n’auraient pas mis obstacle à ce choix. Ce ne sont là que des conjectures ; cependant elles peuvent servir à trouver la vérité. André Brigeot. ([13]) reçut des lettres de noblesse en 1608. Voici le commencement de l’article dans lequel Dom Pelletier traite de sa famille: « Brigeot (André) conseiller-secrétaire ordinaire de feuë S. A., prévôt et controlleur des recettes et gruerie d’Amance, fut annobli par lettres de Henri, duc de Lorraine, données à Nancy, le 6 août 1608. Porte de gueules au chevron d’argent, accompagné de trois sphères d’or, deux en chef et une en pointe; et pour cimier une tête de maure au naturel, environnée de deux pennes. Fol. 245. v. régist 1623. « ANDRÉ BRIGEOT, fils de Demange Brigeot, échevin en la justice d’Amance et de N. - . - l’Allemand, avoit épousé: -1° Françoise de Nay, morte le 21 décembre 1611, âgée de 14 ans et deux mois; et 2°par contrat passé à Amance pardevant Collin, tabellion, le 12 mai 1612 Françoise Dattel », dont il eut, entre autres enfants, « Louis Brigeot, Capitaine et prévôt d’Amance, controlleur en la gruërie des bois dudit lieu », et « André Brigeot IIe du nom, capitaine-prévôt d’Amance ». On retrouvera plus loin (PRINCIPALES INHUMATIONS) l’inhumation, dans la même église, de Françoise Brigeot, morte le 20 mai 1706, âgée de plus de cent ans Françoise Dattel, dont nous rencontrerons aussi plus loin la famille, était fille de Didier II et de Françoise de Mussey. La tombe qui fait l’objet de ce paragraphe est conservée : on l’a replacée vers le bas de l’église, côté de l’évangile. 5. Familles Dattel, Pigeollet, Bastien.1614. Dans la nef, du côté de l’évangile, est une assez grande tombe, sur laquelle nous avons lu: CY GIST NOBLE FEMME HEILLOVY PIGEOLLET VIVANTE ESPOVSE A noble homme Didier D’ATTEL GRVYER d’amaNCE LAQLE DECEDA LE 3e DE DECEMBRE - - CY GIST AVSSY Damoiselle . . - SVSANNE BASTIENNE (née à?) METZ VIVAntE FEmme. - a noble homme. . VE RECEPVEVR D‘AMANCE
CHAR.. IN (?) ELLE TRESPASSA LE DERr IOVR DE SEPTEMBRE 1614 - PRIES DIEV POVR LEVRS AMES Au-dessous se trouvent les armoiries de la famille Dattel un écu, à trois tours, posées 2 et -1; et, pour cimier, une tour entre deux pennes, le tout supporté d’un casque, orné de lambrequins. Voici le commencement de l’article consacré par Dom Pelletier à cette famille, où il nomme Didier et sa femme, Hellouy ([14]) Pigeollot (Sic) ([15]). « Dattel (Didier). gruïer d’Amance, fut annobli par lettres données par le duc Antoine le 20 août 1541. Porte d’azur à trois tours d’argent massonées de gueules; et pour cimier une tour de l’écu entre deux pennes. « Je n’ai point trouvé cet annoblissement au trésor des chartres, je l’ai tiré d’un jugement souverain rendu le 29 octobre 1674, par M. l’intendant de Metz, en faveur de Charles-Henri et Jean-François Dattel ; et dans lequel jugement sont rapportés, entr’autres pièces, les lettres originales d’annoblissement, accordées à Didier Dattel, à la prière de maître René Boudet, maître des requêtes de Lorraine. « Selon les mémoires domestiques de cette famille, elle tire son origine de Sicile, et a apporté sa noblesse d’Italie en Lorraine ; mais comme ils ne nous ont point été communiqués, et que nous-n’en avons point de preuves, nous commençons l’époque fixe de sa noblesse au tems que le duc Antoine accorda des lettres de noblesse à Didier I, qui avoit épousé Hellouy Pigeollot, et dont il eut: 1° Didier qui suit (seigneur voué de Champenoux) ; 2° Barbe, femme de Jean Deschamps; 3° Jean, qui a fait la branche des seigneurs de Marzéville. « Le 10 mai 1544, Didier Dattel et Hellouy sa femme firent un acquêt, dans lequel ledit Didier est qualifié noble homme et gruïer d’Amance. Ils en firent encore d’autres le 29 septembre 1573, et le 21 juillet 1584, dans lesquels il prend la même qualité.. » Plusieurs descendants de Didier d’Attel se rattachent à Amance. Son fils aîné, Dider, voué de Champenoux, y habitait. Le second, Jean I, fut «gruïer, receveur et cellerier d’Amance et de Châteausalin ». Celui-ci eut également deux fils, dont le premier tint la charge de « gruïer et receveur d’Amance », et l’autre, Didier, tige des seigneurs de Veinsberg et de Luttange, devenu maître échevin de Nancy en 1624, conseiller d’Etat de S. A. et de l’empereur Rodolphe II, fut « capitaine héréditaire du château d’Amance ». On trouvera plus loin (PRINCIPALES INHUMATIONS), mention de Françoise d’Atel, morte le 30 mars 1699, âgée de 49 ans, et enterrée dans la même église. « Suzanne Bastien, fille de Thomas Bastien et de Jeanne Sauvage », est la femme de « Jean Dattel, second fils de Didier Dattel et de Hellouy Pigeollot,.. gruïer, receveur et cellerier d’Amance et de Châteausâlin, et seig. voué de Champenoux « . Dom Pelletier leur donne cinq enfants. On remarquera que, suivant un vieil usage dont on retrouve encore quelques traces dans les campagnes, le nom de Suzanne Bastien ([16]) a reçu, dans l’épitaphe, une terminaison féminine. De même, en parlant des enfants, on ajoutait souvent un s au nom de famille, précédé de l’article les. Ainsi, étant donné un personnage nommé Maillet, on appelait sa femme la Maillette, et ses enfants, les Maillets. Plusieurs de ces formes détournées se sont transmises à la descendance et ont fini par devenir des vrais noms de famille ([17]). La tombe dont nous venons de parler est aujourd’hui replacée au bas de l’église, du côté de l’épître.
[1] M. L. Larchey (Dictionnaire des Noms) considère le nom de Gerlet comme une forme intervertie de Grelet signifiant ordinairement un homme de grêle et fluet ; mais il signale plusieurs exceptions pour 1esquelles nous renvoyons à son intéressant ouvrage.. [2] Beaucoup d’auteurs pensent que le mot éployé, qui se rapporte toujours à l’aigle, signifie à deux têtes ; mais, en Lorraine, il semble qu il ne faille, le plus souvent, l’entendre que dans le sens du déploiement des ailes, puisqu’on le rencontre joint aux termes impérial et à deux têtes, avec lesquels il ferait pléonasme: d’ailleurs, au cas particulier, la gravure représente une aiglette ordinaire, un alérion primitif [3] Dom Pelletier, p, 496-497. [4] ldem. p 220. [5] Dom Calmet, Notice de la Lorraine, art- Amance:( t 1. Suppl., col. 16). Cf. Lepage, communes I 23, d’après lay. Amance. — La réimpression de la Notice de la Lorraine faite vers 1840, reproduit inexactement ce passage, ainsi que beaucoup d’autres [6] M. L. Larchey (Dict. des noms) explique ainsi ce nom « BAUDO1N. 1 Nom de saint qui est une forme du vieux nom germanique., Baldin (1088), dérivé de bald: hardi ;2° abréviation de Thibaud. L’abbé Brizard (XVIII) siècle), a trouvé dans une charte les deux noms Thibaud et Baudin, qualifiant la même personne. » Suivant le même auteur, le prénom Dion est. une abréviation de Didion, dérivé de Didier (Desiderius). [7] Contrerolleur, contrôleur. [8] M. L. Larchey ne donna pas cette forme, ni celle de Ney ; on trouve dans son Dict. des noms « Nais Naïf (oil)» et « Née, Lieu humide, marécageux (oil) ».
[9] M. L. Larchey donne Mory comme une variante de « Maury, forme méridionale de Maure, on abréviation d’Amaury ». La seconde signification doit être, ce nous semble, la plus fréquente mais la première explique les armes parlantes de plusieurs familles qui portaient dans leurs écussons, ou en cimier, des « têtes de –maures ». [10] Nobiliaire, p. 586. [11] V Généalogie et journal de famille de Mory d’Elvange, par l’abbé Guillaume, dans les Mem. de la Soc. d’Arch. Lorr. de 1881 - V. aussi notre article Une erreur de Dom Pelletier. – Mercy, Morey, Mory, Nancy, 1885 [12] Cette « tète de nègre », ou tête de Maure, est parlante, ainsi que-nous l’avons expliqué dans l’une des notes précédentes. [13] M. L Larchey ne donne pas ce nom, ni son similaire Bregeot (V. le Nobiliaire) on doit sans doute les rapprocher de Bregeon, que cet auteur regarde comme une forme de Bergeon, mais dont il ne fournit point l’explication d’une manière précise. [14] Prénom à rapprocher d’ Helouis et Heluis, qui, suivant M. L. Larchey, offrent le même sens qu’HERLOUIN : « Nom de saint. En latin Herluinus. Du vieux nom germanique Herloin (comte-ami) 762 »; ou « doivent venir éga1ement de Erl (comte), mis en opposition avec wis (sage) Le seul exemple cité par Fœrstemann est Erlois » [15] M. L. Larchey ne donne pas ce nom, qui est peut-être à rapprocher de « PIGEAU. Noir et blanc, rouge et blanc (Poitou) Surnom de visages grivelés ou de chevelures grisonnantes ». Voir aussi « PIGEAIRE, PIGEARD, PIGEAT. Taché de rousseur (oc). » [16] Bastien, avons-nous besoin de le rappeler, est une abréviation de Sébastien. [17] Cf. nos articles L’éqlise de Maxéville, 1889, p 46 47, et Note sur l’origine de Florentin le Thierrat 1882 p 2 note 1 -
[i] Encyclopédie de Diderot et d'Alembert HAMEIDE, s. f. terme de Blason, fasce de trois pièces alaisées qui ne touchent point les bords de l'eau. Hameides, selon le père Menétrier, sont trois chantiers ou longues pièces de bois en forme de fasces alaisées qui se mettent sous les tonneaux qu'on nomme hames aux pays-bas ; ce qui a fait le mot d'hameides ; une famille de Flandres qui porte ces chantiers pour armoiries par allusion à son nom, en ayant introduit l'usage dans le Blason. Il ajoute qu'hameide est encore une barrière dans ce pays-là, où les maisons de bois traversées se nomment hames, d'où vient le nom de hameau, à cause des maisons de village bâties de cette sorte, & des barrières dont les chemins sont fermés en Suisse & en Allemagne sur les avenues de ces hameaux. D'autres croyent qu'hameide vient de la maison de ce nom en Angleterre, qui porte pour armes une étoffe découpée en trois pièces en forme de fasce, qui en laisse voir une autre par ses ouvertures, qui est d'une couleur différente & mise au-dessous. On dit aussi hamade & hamaide. Dictionn. de Trévoux. [ii] Juridiction forestière |
|
Vous êtes
le Ce site est un site privé, indépendant des communes et groupements cités. |