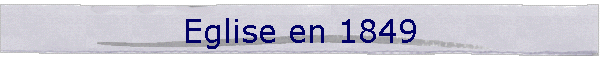
|
|
Bulletin monumental publié par la Société française d'archéologie pour la conservation et la description des monuments historiques 1849NOTICE SUR L'ÉGLISE DE LAÎTRE-SOUS-AMANCE Par M. Auguste DIGOT, Inspecteur de la Société française pour la conservation des Monuments. Nous avions, il y a quelques années, formé le projet de composer une sorte d'aperçu général sur les caractères particuliers que présentent les églises romaines et ogivales de la Lorraine. Placée entre la France et l'Allemagne, sur la limite des deux langues et des deux civilisations, cette province offre sous le rapport de l'architecture, comme sous beaucoup d'autres, un intérêt assez grand ; et un travail de la nature de celui dont nous parlons aurait été destiné, s'il eût été complet, à faire disparaître une lacune regrettable. Différents motifs nous ont engagé à abandonner ce projet ou du moins à en ajourner l'exécution, et nous avons pensé qu'il valait mieux nous borner à publier des notices sur les édifices religieux les plus remarquables, soit par leur ancienneté, soit par leur importance, Ce n'est pas, au reste, la difficulté d'examiner et d'étudier un grand nombre d'églises qui nous a porté à restreindre et à modifier notre plan primitif; car nous avons fait observer ailleurs que notre province est une de celles qui ont conservé le moins de monuments élevés pendant les périodes romane et ogivale. Mais nous avons été arrêté par la pénurie des renseignements, et nous n'avons encore pu voir par nous-mêmes tous les édifices dont nous aurions dû parler, Plusieurs sont perdus au fond des campagnes et éloignés des voies de communication. En attendant que l’on ait réuni les matériaux nécessaires pour composer le mémoire important dont il était question tout à l’heure il est bon de publier des notices succinctes sur les édifices que l'on a pu examiner en détail ; elles tiendront provisoirement lieu des aperçus généraux sur l'architecture religieuse de la Lorraine, et aplaniront le chemin devant celui qui voudra plus tard mener à bonne un cet intéressant travail. Le nom de l'église à laquelle est consacrée cette notice n'est pas complètement étranger aux lecteurs du Bulletin monumental. Ils ont vu, l'année dernière, dans ce recueil une note sur des carreaux de terre cuite qui avaient servi autrefois, et qui servent même encore aujourd'hui de pavé à l'église de Laître, Nous avons dit que cette église remontait au XIe siècle ; c'est une antiquité assez respectable, et en Lorraine, comme ailleurs et plus qu'ailleurs les édifices de cette époque ne sont pas communs. Au nord-est, et à 15 kilomètres environ de la ville de Nancy, s'élève une montagne assez haute, sur laquelle on avait construit autrefois un château très-fort et très important, qui se nommait Amance, et qui servait de boulevard à la Lorraine du côté de l’évêché de Metz. Une petite ville, dont il est assez difficile d'apprécier maintenant l'étendue couvrait une partie du sommet de la montagne. Sur le flanc et presqu'au pied de cette hauteur, du côté du midi, on voit un village, qui porta d'abord le nom de Sainte-Marie et que l'on appelle maintenant Laître-sous-Amance, pour indiquer sa position relativement à la petite ville dont nous venons de parler. Ce nom de Laître (l’aître, atrium) paraît provenir d'un vaste cimetière, qui aurait été établi au bas de la montagne, et qui aurait servi aux villages voisins, ainsi que c'était autrefois la coutume. A une époque fort reculée, les villages de Lay-Saint-Christophe, Eumont, Blanzey, Laître, Séchamp, le château et la ville, ou pour mieux dire le bourg d'Amance dépendaient pour le spirituel de l'église de Dommartin, qui se trouve placée à peu près au milieu de ces différentes localités ; et le cimetière de Laître était probablement celui de cette immense paroisse. Quoi qu'il en soit » nous ne savons pas à quelle époque eut lieu ce changement de nom, et au commencement du XIIe siècle Laître s'appelait encore Sainte-Marie-sous-Amance. Thierry I, comte de Bar ([1]), qui était maître du château d'Amance, commença, peu de temps avant sa mort, la construction d'une chapelle au-dessous du château ; il voulait la faire consacrer sous l'invocation de saint Sigismond. Sa mort arrivée en 1024 l'empêcha d'accomplir son projet ([2]). Ce fut seulement un demi-siècle après, en l'année 1075 ou 1076, que la célèbre comtesse Sophie, petite-fille de Thierry, résolut de terminer la fondation ébauchée par ce prince. Comme la chapelle commencée vers l'année 1022 était trop petite, Sophie ordonna de la raser complètement et d'en élever une autre, qui fut bientôt achevée. Elle la donna a l’abbaye de Saint-Mihiel , avec la chapelle du château d'Amance, et pria Pibon, évêque de Toul , de procéder à la consécration de la nouvelle église ; mais Hodierna, abbesse de Sainte-Glossinde de Metz y mit opposition et fît observer que la cure de Dommartin appartenait à son monastère, que Laître dépendait de Dommartin, et qu'un démembrement de cette juridiction ne pouvait s'opérer si elle n'y donnait son consentement. Sophie, qui ne put méconnaître la justesse de cette réclamation, engagea l’évêque de Toul et Hériman, évêque de Metz, à ménager une transaction. Cette transaction eut lieu ; Sophie abandonna à l'abbaye de Sainte-Glossinde quelque cens à Lay-Saint-Christophe, trois serfs nommés, Arenfrid, Badin et Lampihon, avec les terres que ceux-ci cultivaient, une forêt à Ingeviler (Eingweiller ?) et trente livres messines. Il n'y eut plus alors aucune opposition à la consécration de l'église de Laître ; Pibon y procéda en 1085 ; la nouvelle église fut dédiée à sainte Marie, et la comtesse de Bar, pour récompenser l'évêque de ses bons offices, confirma la donation faite par ses prédécesseurs à l’église de Toul d'une maison située près de la porte d'Amance ([3]). L'année suivante (1086), l'évêque de Toul, à la prière de la comtesse Sophie, donna une seconde charte, par laquelle il faisait connaître que l'église de Sainte-Marie-sous-Amance était libre et franche de toute juridiction, et que les habitants de Lay-Saint-Christophe, d'Eumont, de Blanzey, de Séchamp et d'Amance dépendraient à l'avenir de cette église et non de l'église de Dommartin ([4]). Sigefroi , qui était alors abbé de Saint-Mihiel , se hâta de fonder un prieuré près de l'église de Laître, et y envoya quelques-uns de ses religieux. Au reste, ce prieuré fut toujours peu considérable ; en effet, la comtesse Sophie ne lui avait donné que quatre manses, un serf, deux serves, les dîmes grosses et menues du château et du bourg d'Amance, les cens et les dîmes des places vides, des défrichements et des fonds seigneuriaux. Les Bénédictins de Laître exercèrent une heureuse influence dans ce canton, dont les habitants, ceux d'Amance au moins, étaient si grossiers et si violents que jamais, au dire de l'évoque Pibon, aucun archidiacre, aucun doyen n'avait osé y faire de visite, pour réformer les abus. L'histoire du prieuré de Laître est peu intéressante ; nous dirons seulement ici qu'une léproserie fut établie à peu de distance du prieuré, que, vers la fin du XVe siècle, les religieux firent en partie reconstruire leur église, et que saint Laurent en devint le patron. Supprimé à la révolution, comme tous les autres établissements du même genre, le prieuré fut démoli peu de temps après, et il ne reste que l'église, dont la description fait l'objet de ce mémoire. La date de cette église ne peut donner prise à la moindre incertitude, c'est vers 1075 ou 1080 au plus tard que la comtesse de Bar en commença la construction, et comme l'édifice était peu considérable, et que cette princesse disposait de grandes ressources, il fut achevé, sans aucun doute, au bout de quelques années. Nous avons donc un spécimen authentique, et avec date certaine, du style roman secondaire ; mais ce spécimen, comme nous l’avons dit, n'est malheureusement plus intact. Il ne reste de l'église ancienne que le portail jusqu'à la hauteur d'une corniche garnie de billettes, la première travée de la nef, ou pour mieux dire, le porche, et les murailles de la nef et de l’abside. . La façade occidentale de l'église de Laître est couverte presqu'entièrement par cinq grandes arcatures, qui en forment la décoration. Celle du milieu, qui est ouverte, sert de porte ; elle est en plein-cintre. Les deux arcatures les plus rapprochées de cette porte sont ogivales ; enfin, les deux plus éloignées sont en plein-cintre ; elles sont aveugles toutes quatre, et n'ont d'autre destination que de dissimuler la nudité de la muraille. Ces arcatures sont plus hautes que celle du milieu et ne présentent aucun ornement Cette manière de décorer et de fortifier les façades a été fort usitée, comme l'on sait, pendant la période romane secondaire en Lorraine comme ailleurs; nous l'avons retrouvée notamment dans les restes de l’église prieurale de Varangéville ; nous nous contenterons en conséquence de l’indiquer, mais ce que nous devons faire remarquer, c'est la présence de deux arcatures ogivales alternant avec trois arcatures romanes. Nous n’ignorons pas que l'ogive est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'avait supposé d'abord ; mais il n'en est pas moins vrai qu'en France, et surtout dans les provinces orientales, qui ont dû ressentir l'influence de l’école architecturale de la Germanie, il est rare de rencontrer des ogives avant le XIIe siècle; et c'est un fait assez curieux que de voir des ogives parfaitement caractérisées, quoique peu aiguës, dans un monument construit vers l’année 1080. L'arcature centrale, qui sert de porte, est décorée de quatre petites colonnes, logées dans les angles de deux rentrants égaux. Ces colonnes, qui ont un diamètre de 18cm et 2m 60cm. de hauteur, supportent une archivolte que nous décrirons un peu plus bas. De chaque côté du portail, et auprès des colonnes dont nous venons clé parler, se trouve un groupe de deux colonnes engagées dans la façade. Leur module est à peu près le même que celui des colonnes dégagées, mais leur hauteur n'est pas égale ; les plus rapprochées de la porte ne s'élèvent pas plus que les colonnes et leurs chapiteaux se touchent et se confondent en quelque sorte ; mais les deux autres sont bien plus élancées, et vont soutenir la retombée des arcs ogivaux que nous signalions. Les bases des colonnes dégagées du portail sont uniformes. Elles se composent de deux socles carrés, en retraite l'un sur l'autre, et de différentes moulures rattachées au socle supérieur par des pattes assez élégantes. Chaque couple de colonnes engagées repose sur un lion accroupi et occupant un socle carré d'une certaine hauteur. Ces lions, de petites dimensions, sont aujourd'hui fort mutilés ; leur rapprochement du sol les exposait, en effet, à des chocs fréquents. Ils n'ont plus de têtes, mais ils sont néanmoins encore parfaitement reconnaissables ; et l'on sait que pendant la période romane il était d'usage de placer ainsi des lions à l'entrée des églises, sous les colonnes du portail, comme à Laître, ou supportant les colonnes d'une espèce de vestibule. Les chapiteaux des quatre colonnes dégagées et des deux autres colonnes les plus voisines présentent une grande variété. Le tailloir, qui est moins élevé que dans la plupart des chapiteaux de cette époque, et la corbeille, sont couverts d'ornements d'un très-bon goût, c'est-à-dire de fleurs, de fruits, d'oiseaux, de palmettes et de galons perlés. Une description particulière de chacun de ces chapiteaux nous entraînera trop loin, et il suffit d'ailleurs, pour en avoir une idée, de jeter les yeux sur le dessin joint à ce mémoire, et que nous devons à M. Miller Fils, membre de la Société d'archéologie lorraine. Les chapiteaux des deux colonnes engagées les plus éloignées de la porte n’ont pas de tailloirs et se composent, sans parler d'une moulure qui termine le fût, d'une corbeille offrant quelques ornements végétaux et un oiseau, assez bizarrement contourné et couvrant de ses ailes la corbeille presque tout entière. Les chapiteaux des deux autres colonnes engagées présentent une singularité que nous n'irons jamais rencontrée ailleurs et qu'il importe de signaler ici ; sur les tailloirs qui terminent ces chapiteau, on voit à droite, en entrant, une paire de bœufs accroupis, dont la tête est surmontée du joug ; à gauche un couple d'hommes prosternés. Ce dernier groupe est fort mutilé, mais on ne peut avoir le moindre doute sur la nature des figures qui le composent ; les bœufs, au contraire, sont dans un assez bon état de conservation. Ces sculptures ont donné lieu comme il est facile de le penser, à différents commentaires ; mais aucune des explications hasardées jusqu'ici ne nous a satisfait, et il est probable que les quatre statuettes de Laître-sous-Amance continueront encore pendant quelque temps à exercer la sagacité des archéologues. L’archivolte est formée de deux nervures cylindriques assez fortes, ou pour mieux dire de deux gros tores, qui viennent reposer sur les chapiteaux des colonnes dégagées. Celui de ces deux tores qui circonscrit le tympan est décoré d'une guirlande très gracieuse, formée de fleurs et de fruits fantastiques, entremêlés de palmettes et de galons perlés. L'autre tore est lisse, à l'exception cependant de la partie qui avoisine les chapiteaux, et sur laquelle on a sculpté, de chaque côté, en bas-relief un personnage assis qui tient une espèce de palme et paraît être un religieux. Les deux tores sont séparés par une moulure plate représentant un bandeau tressé. Une autre moulure du même genre, mais entièrement lisse, sépare le tore dont nous venons de parler d'une troisième nervure cylindrique, moins volumineuse, qui retombe sur les chapiteaux supportant les deux groupes d'hommes et de bœufs. Enfin, un bandeau assez large vient encadrer le tout et termine l'ornementation de l'archivolte. Ce bandeau, qui ne repose sur rien, et dont les extrémités arrivent jusque sur le fût des deux colonnes engagées les plus extérieures, est couvert d'un ornement en zigzag, tellement rare dans notre province qu'il nous serait difficile d'en citer un autre exemple. Le tympan de la porte offre un bas-relief d'un travail fort incorrect. Au centre Notre-Seigneur Jésus-Christ, assis au milieu d'une gloire elliptique, la tête environnée du nimbe crucifère, tient un livre de la main gauche et bénit de la main droite. De chaque côté on voit un ange nimbé, debout dans l'attitude de l'adoration et de la prière, et un personnage sans nimbe, agenouillé, portant un habit assez long, et dans la même attitude que l'Ange. Quelques-unes de ces sculptures naïves ont malheureusement souffert ; le visage du Christ notamment est aujourd'hui complètement mutilé ; cet acte de brutalité sacrilège a sans doute, été commis pendant la première révolution. Un peu au-dessus des cinq arcatures dont il vient d'être question, et sur toute la largeur de la façade, règne une corniche garnie de deux rangs de billettes, et surmontée de deux revers d'eau superposés en gradins retraités et rampants. Cette corniche s'arrête aux angles de la façade, et n'a pas de retours sur les murs latéraux, Toute la façade que nous venons de décrire est construite en pierres de taille d'assez petit appareil, mais sans régularité; la base et la porte présentent seules des pierres d'une plus grande dimension. L'espace compris entre l'archivolte de la porte et la corniche est occupé par un bas-relief d'une époque comparativement récente ; on ne peut, en effet, le faire remonter plus haut que la fin du XVe siècle. Ce bas-relief est divisé en cinq niches ogivales fort richement sculptées ; dans la niche du milieu, on voit la Sainte Vierge assise et tenant l’enfant Jésus sur ses genoux ; à sa droite est un personnage agenouillé, sans doute le donateur de ce petit ouvrage. Les quatre autres niches sont remplies par des saints, que nous n'avons pu reconnaître, parce que la pierre, qui était de mauvaise qualité, s'est pulvérisée en plusieurs endroits; cependant nous pensons que la dernière niche, à la droite du spectateur, contient saint Michel foulant aux pieds le dragon. Malgré les mutilations qu'il a subies et l'effet destructeur du temps qui a rongé les sculptures, 1e portail de Laître est d'un effet à la fois simple et gracieux, et nous le donnerions volontiers pour modèle à ceux qui voudraient construire une église rurale élégante et peu coûteuse. Malheureusement la partie supérieure de cette façade ost détruite, et tout ce qui surmonte la corniche à billettes est de construction moderne. Nous ne nous arrêterons pas à décrire cette lourde tour qui a remplacé la tour romane ([5]) ; une inscription, placée au-dessus de la corniche, a soin de rappeler aux antiquaires et aux curieux que les derniers travaux ont été terminés en 1774 ; nous croyons cependant que la destruction de la tour romane est plus ancienne, et que cette tour a péri avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. La longueur de l'église de Laître est de 30m 60 cm· dans œuvre, et la largeur également dans œuvre de 8m 60 cm. La grande nef a sous clé une hauteur de 6m 30cm. L'église forme six travées; savoir, une travée romane joignant immédiatement le portail et appartenant à la construction primitive., trois travées pour la nef, une tenant lieu de transept, mais à peu près semblable aux précédentes, et une autre pour l'abside. La travée romane se compose d'une arcade en plein-cintre surbaissé, qui répond à la nef principale et en occupe toute la largeur, et de deux demi-arcs qui viennent buter contre les murs latéraux. Cette disposition assez singulière n'est pas cependant tout-à-fait insolite, et les églises romanes en offrent quelques spécimens ; mais il arrive ordinairement que les courbes incomplètes des demi-arcs s'appuient contre les arcs complets de la nef centrale et non contre les murailles, qu'un semblable fardeau pourrait faire surplomber. Les arcs de la travée dont nous parlons retombent sur deux piles isolées et sur des groupes de pilastres de formes lourdes et sévères. Les bases ne présentent aucune particularité intéressante; les chapiteaux sont formés d'un quart de rond écrasé, et d'un tailloir carré et entièrement nu. Les quarts de rond, au contraire, sont couverts d'ornements analogues à ceux des chapiteaux du portail, c'est-à-dire de palmettes, de fleurs, de fruits ouverts, de feuilles largement sculptées. Les deux piles isolées, qui supportent partiellement les retombées de la voûte de la première tracée, offrent, sur les faces regardant l'axe longitudinal de l'église, deux colonnes engagées, dont les chapiteaux se composent d'un tailloir, d'un quart de rond, d'une corbeille à peu près semblable à celle du chapiteau corinthien, et garnie de palmettes, de rubans perlés et entrelacés, et d'autres ornements du même genre que ceux des chapiteaux du portail. Cette travée romane est d'une exécution remarquable, et l'on y retrouve, comme dans toute la partie ancienne de l'église, une heureuse combinaison des lignes, des proportions gracieuses. une grande correction dans le dessin des ornements et du fini dans leur exécution. Tel est le jugement porté par un habile architecte, M. Châtelain, auquel nous devons quelques passages de cette notice. Les murailles de l’église sont encore les murailles primitives ; elles sont fort épaisses, mais ne présentent dans leur construction et leur appareil aucune particularité digne de remarque, Ces murailles diminuent d'épaisseur vers le haut ; dans cet endroit, presque immédiatement sous la toiture, et au-dessus des voûtes actuelles, on voit quelques petites fenêtres romanes, fortement ébrasées en dehors, sans ornements, et à claveaux réguliers. À côté de ces fenêtres se trouve un oculus de la même époque ; au reste, il n'y a de ces petites baies que sur le flanc méridional de l'église ; le flanc septentrional est engagé dans un massif de maisons, et on ne peut examiner quel était de ce côté l'état premier du mur. A l'extrémité du bas-côté septentrional on aperçoit les traces d'une fenêtre romane, aujourd'hui entièrement bouchée. Nous n'avons que peu de choses à dire de la partie ogivale de l'église ; elle est d'un style lourd, et les détails n'offrent que peu d'intérêt Les nefs sont éclairées par des fenêtres cintrées, fort maussades, percées à peu de hauteur du sol, et après coup, dans les anciennes murailles. La nef principale et les nefs latérales sont voûtées en ogive, avec arcs-doubleaux, nervures prismatiques et clés historiées. Les voûtes reposent sur des piliers bizarres; ils sont formés : 1° d'un massif carré en maçonnerie, avec base et chapiteau en pierres de taille ; les bases sont élevées, et les chapiteaux, qui sont écrasés, ont un tailloir d'une épaisseur assez considérable ; il semble que l'architecte a voulu imiter les pilastres romans de la première travée ; sur les chapiteaux de ces massifs reposent les arcades qui donnent entrée dans les nefs latérales; 2° d'un segment de pilastre demi-cylindrique, à chapiteau évasé, sans tailloir, et qui soutient les arcs séparant les travées, et les nervures des arcs-doubleaux. Dans une des travées, on voit encore au-dessus de ce pilastre un autre petit pilastre également cylindrique, sur lequel viennent s'appuyer une partie des nervures prismatiques dont il a été question tout à l'heure. Les chapiteaux de ces petits pilastres sont ornés de fleurs rondes, tellement empâtées par le badigeon qu'il est difficile d'en déterminer l'espèce. On est maintenant obligé de gravir quelques degrés pour pénétrer dans l'abside. Cette abside, dont les murailles appartiennent, comme celles delà nef, aux constructions du XIe siècle, est de forme carrée ; elle est éclairée par deux baies ogivales percées dans les parois latérales, et qui ne méritent pas une description particulière; elle l'était autrefois par trois fenêtres romanes accolées et pratiquées dans la muraille du fond. Ces trois fenêtres symboliques, que l'on retrouve dans plusieurs églises de cette époque, sont accompagnées de colonnettes; elles sont aujourd'hui complètement murées et de plus masquées par un grand tableau, qui ne permet pas de les examiner avec soin. Il n'y a point d'absides latérales. Les bas-côtés se terminent carrément, et on a placé à leur extrémité les deux autels que l'on élevait ordinairement dans les petites absides. Près d'un de ces autels, dans le mur septentrionale et dans la travée qui tient lieu de transept, on voit encore les contours de la porte par laquelle l'église communiquait avec les bâtiments du prieuré. La description sommaire qu'on vient de lire a dû faire comprendre la singulière disposition de l'église de Laître. C'est véritablement un édifice enfermé dans un autre ; on a conservé des premières constructions tout le vaisseau, et dans cet intérieur vide et spacieux on a bâti une église ogivale ; de sorte que les fenêtres romanes qui introduisaient le jour dans l'édifice primitif sont maintenant, comme nous l'avons fait remarquer, au-dessus des voûtes et n'éclairent plus qu'une espèce de grenier. Plusieurs indices permettent encore de déterminer quelle a été l'ordonnance de l'église romane. Cette église n'a jamais été voûtée, et, malgré sa largeur, elle ne formait qu'une seule nef. Les poutres qui soutenaient le plafond étaient assises sur les murailles latérales, et la nef était éclairée : 1° par une ligne de petites fenêtres et d'oculi percés dans la partie haute des murailles, 2° par deux autres baies de plus grandes dimensions, qui avaient été pratiquées à l'endroit où la muraille de la nef tournait à angle droit pour rejoindre celle de l'abside, c'est-à-dire au-dessus des deux petits autels que l’on voit maintenant II serait cependant encore possible que l'intérieur de l'église romane eût été disposé comme celui de l'église de Champ-le-Duc, que nous avons décrite dans le Bulletin monumental ([6]), et, dans cette hypothèse, les petites fenêtres et les oculi n'auraient éclairé que les greniers placés au-dessus des bas-côtés ; mais la première supposition nous semble bien plus vraisemblable. On voit encore dans l'église de Laître quelques restes du pavé primitif. Nous avons donné, l’an dernier, dans le Bulletin monumental ([7]), des détails sur cette précieuse relique, et l’on nous permettra de les reproduire ici. Les carreaux en terre cuite employés à ce pavage sont, disions-nous, au nombre de quarante à cinquante ; ils ne sont pas vernissés, mais couverts d'ornements qui ont été imprimés sur l’argile, avant qu'elle fût desséchée. Ces ornements ont été tracés au moyen d'une espèce de griffe ou de timbre. Les briques de Laître peuvent se diviser en deux catégories ; les unes sont carrées et les autres oblongues. Les briques carrées sont elles-mêmes de grandeurs différentes. La plupart ont 9 cm en tous sens; les autres en ont 14. En général, les ornements qui les couvrent sont géométriques et presque tous se composent de courbes diversement enlacées. D'autres briques, et ce sont les plus grandes, présentent des ornements plus compliqués. Les briques oblongues ont 9 cm· de largeur sur 18 de longueur. Elles offrent soit des lignes droites, qui se coupent de manière à former des carrés, soit des rinceaux d'assez bon goût, enfermés entre deux bandes chargées de hachures. Toutes ces briques étant engagées dans le pavé actuel de l'église, nous n'avons pu constater leur épaisseur. Il nous semble certain que ces carreaux se disposaient de la manière suivante qui présente de l'analogie avec nos parquets modernes. Les briques oblongues formaient des encadrements, dans lesquels on rangeait l'une à côté de l'autre un certain nombre de bloques carrées. Et il est bon de faire remarquer ici que le rapprochement de ces briques produisait des courbes et des cercles qui devaient être d'un fort bel effet. Au pied des degrés que l'on monte pour entrer dans l'abside se trouvent deux pierres tumulaires d'assez grandes dimensions. Sur l'une d'elles qui est du XVIe siècle (1535), on voit un personnage vêtu d'une longue robe et portant des souliers pointus; mais la légende est trop fruste pour être déchiffrée. L'autre pierre est du XVe siècle ; elle offre l'image et l’écusson d’un secrétaire du duc de Lorraine ; la légende est fort maltraitée, toutefois on peut encore lire les mots suivants : Poiret. damance. secretaire. monsr. de loherene x jaidit. receu de volc. t. cest trespassa. lan. .m. cccc. Tel est l'état de l'église de Laître-sous-Amance, un des rares débris d’architecture romane que possède la Lorraine ; on voit que ce qui a survécu, dans cet édifice,· aux efforts du temps et au vandalisme des hommes est bien peu considérable auprès de ce qui a disparu pour toujours ; et encore la conservation de ces restes précieux doit-elle inspirer de sérieuses inquiétudes. La commune de Laître, n'ayant que peu de ressources, n'a pu entretenir son église d'une manière satisfaisante. Les poutres qui soutiennent la toiture sont vermoulues ; quelques-unes ont fléchi et s'appuient aujourd'hui de tout leur poids sur l'extrados de la voûte ogivale; cette voûte, légère comme celles que l'on construisait au XVe siècle, est évidemment hors d'état de supporter cet énorme fardeau ; plusieurs lézardes se sont manifestées depuis quelque temps. D'un autre côté, la poussée de la voûte s'est beaucoup augmentée, et, comme les murailles qui en supportent une partie ne sont pas munies de contreforts, il est à craindre qu'elles ne viennent à céder. Le mur latéral du côté du midi surplombe déjà d'environ 8 cm · et cette déviation ne s'arrêtera sans doute qu'avec la disparition des causes qui l'ont produite. L'administration de l'église de Laître est heureusement confiée à un jeune prêtre plein de zèle, qui voit avec douleur le dépérissement de ce curieux édifice, et s'occupe activement des moyens d'en prévenir la ruine. Mais les ressources locales sont bien faibles, et le rétablissement total de la toiture exigera une dépense considérable ; il serait donc urgent que l'on aidât les habitants de Laître, et que le gouvernement ou le conseil général accordât une allocation qui sauverait une église importante au point de vue de l'art et de l'histoire.
[1] Thierry était en même temps duc bénéficiaire de la Haute-Lorraine, c'est-à-dire de la partie du royaume de Lorraine qui forma plus tard le duché héréditaire. [2] V Mabillon , Annales Bénéd, t, V, p. 217 : Dom Calmet, Hist. de Lorraine 1ère édit, t. l, preuves, col. 482. [3] L’original de la charte contenant l'accord fait entre la comtesse Sophie et l’abbesse de Sainte-Glossinde est détruit depuis longtemps, mais on en avait conservé une copie dans l’ancien cartulaire de l’abbaye de Saint-Mihiel, et c'est d'après ce cartulaire que Dom Calmet a publié la pièce en question dans les preuves de son Histoire de Lorraine 1ère édit. t. I ~ col 483 et 483, Pibon avait donné, à la même occasion, une charte qui était transcrite dans le même cartulaire, mais qui n'a jamais été imprimée. [4] Cette charte se trouvait, comme les deux précédentes, dans l'ancien cartulaire de Saint-Mihiel, elles portaient les numéros 82, 83, 84, et remplissaient les pages 154 à 158. Il y en a d'autres copies mais d'une date récente, dans les papiers du prieuré de Laître, déposés aujourd'hui aux archives du département de la Meurthe. Dom Calmet a fait imprimer dans les preuves de son Histoire de Lorraine, vol. cité, col. 475 et 476 cette seconde charte de Pibon, mais il n'en pas indiqué la véritable date. [5] Un vieillard de Laître assure que l'ancienne tour se trouvait sur le côté méridional du portail ; mais il nous semble évident que ce vieillard se trompe. [6] Tome XIV, p· 445 et suiv. [7] Même volume, p 714 et 715. Quant au portail, sa présence dans cette façade soulève un problème. Selon toute vraisemblance, c’était un portail jadis placé latéralement dans un bas-côté de l’église, selon l’usage lorrain le plus constant. A une époque indéterminée, mais qu’on peut situer vers le XVIIIème siècle, peut-être au moment où la tour fut reprise, c’est-à-dire en 1774, le portail fut démonté et transféré au milieu de la façade occidentale pour la doter d’une entrée qui lui faisait défaut jusqu’alors. On aura réalisé à Laître-sous-Amance une opération semblable à celles qu’on accomplit plus tard à Pompierre et, dans une certaine mesure, à Epinal. Le fait que la façade à arcature préexistante ait été partiellement respectée explique les anomalies de raccordement bien visibles et montrent le défaut des proportions du portail par rapport à la façade. Le portail est trop large. Son archivolte à zigzags aurait dû, normalement, au lieu de s’interrompre avant la fin de ta course, retomber sur des colonnettes. Ces dernières existent, mais on les a prolongées on hauteur jusqu’aux sommiers des arcades aveugles. Cc raccordement bizarre est certes maladroit, mais il aurait été bien plus apparent si le portail entier normalement terminé avait été encastré dans la façade sans tenir compte de l’arcature aveugle. Le rétrécissement artificiel des deux arcades voisines du portail, l’encastrement du portail à l’emplacement qui est le sien à présent furent, à l’évidence, des opérations de diversion esthétique tendant à atténuer l’effet fâcheux produit par l’interpolation brutale du portail dans un contexte architectural fort différent du sien primitif. Le vieillard ne se trompait donc pas! Liens sur le pavement de l'église : http://home.tiscalinet.be/vauclair/PAVEMENT3.htm http://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/samf/grmaison/themrech/carro021.htm |
|
Vous êtes
le Ce site est un site privé, indépendant des communes et groupements cités. |