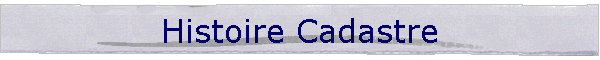
|
|
|
Dès l’origine des sociétés, la terre constitue la base essentielle de la richesse individuelle. Pour subvenir à leurs besoins, les collectivités nouvelles créent un prélèvement sur les produits de cette richesse naturelle donnant ainsi naissance à la contribution foncière. Connaître l’étendue et la nature des biens de chacun, en faire l’évaluation, se révèle très vite nécessaire afin de répartir équitablement cette contribution. C’est l’origine du cadastre, institution remontant à la plus haute antiquité. Une tablette d’argile datant de 2300 an av. J.-C. et donnant le plan coté, la superficie la description d’un groupe de parcelles, a été retrouvée à Telloh dans le désert d’Arabie. Les Egyptiens, les Grecs, les Romains connaissent le cadastre (le cens est utilisé pour l’assiette de l’impôt dont les livres de répartition s’appellent capitastra). Au Moyen Age, le cadastre a pour objet l’établissement de la taille dans les provinces où celle - ci est réelle. Des registres descriptifs et évaluatifs de la propriété appelés polyptyques, pouillés, livres terriers.., accompagnés parfois de plans de valeur très variable suivant les contrées constituent une présentation grossière de l’état parcellaire. Jusqu’à la Révolution de 1789, le cadastre conserve dans notre pays un caractère essentiellement local en dépit de diverses tentatives. Des rois, Charles VII, Louis XIV Louis XV, envisagent tour à tour le projet d’un cadastre régulier, base d’un système fiscal cohérent et applicable à tout le royaume. La pénurie des finances, le défaut d’instruments et de méthodes perfectionnées, la résistance des grands vassaux, la disparité des provinces (coutumes, langages, mesures... ) font échouer ces tentatives. Seules certaines provinces vont se doter d’une institution dont les avantages paraissent évidents. A la veille de la Révolution, l’assiette de l’impôt repose sur le même mode que celui prescrit par le droit romain: déclaration des propriétaires sur la contenance et le revenu de leurs biens, sous la surveillance de commissaires. Dès l’ouverture des États Généraux de 1789, 73 assemblées électorales de la Noblesse et 58 du Tiers État, réclament l’exécution d’un cadastre général, seul système capable de mettre fin à l’arbitraire existant. L’assemblée Constituante, par la loi du 1er décembre 1790, supprime les anciens impôts, taille, vingtième, capitation, dîme, et les remplace par une contribution unique. Toutefois, cette loi n’ordonne pas l’établissement des plans. Les décrets des 21 août et 23 septembre 1791 autorisent enfin les directoires des départements à prescrire le levé du plan parcellaire des territoires. Cependant, l’application de ce levé, à la charge des communes, restera limitée. La loi du 22 brumaire an VI (12 novembre 1797), complétée et étendue par la loi organique du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798) crée l’administration des contributions directes chargée d’assurer la juste répartition de l’impôt. Toutefois, un cadastre parcellaire général n est pas encore envisagé. Le système est toujours basé sur la déclaration des propriétaires. L’Administration reconnaît enfin la nécessité d’une opération générale pour déterminer la contenance de chaque propriété et son revenu, mais le coût de l’opération et ses délais font recu1er les pouvoirs publics. Un arrêté des consuls du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) décide un «cadastre général par masses de cultures» dans 1915 communes. Un plan établi à l’échelle de 1/5000e présente la situation du territoire de ces communes en masses circonscrites par des limites naturelles. Dans chacune de ces masses, les propriétaires déclarent la contenance des parcelles possédées. L’opération, ayant suscité des plaintes des maires, des conseils généraux et des propriétaires, est suspendue après cinq ans de travaux. L’arpentage général de toutes les parcelles du territoire devient donc indispensable. La loi du 15 septembre 1807 est à l’engin du cadastre parcellaire français. Les travaux commencés en 1808 progressent rapidement jusqu’en 1814 puis plus lentement de 1814 à 1821. A partir de 1822 ils se développent à un rythme accéléré et s’achèvent en 1850 dans la France continentale. Ils se poursuivent en Corse et dans les territoire annexes (Comté de Nice et de Savoie) après cette date. Ce cadastre parcellaire, appelé «ancien cadastre », reste cependant figé, aucune mise jour du plan n’étant prévue. La situation parcellaire va se transformer avec l’évolution générale de l’économie rurale,. le développement de l’urbanisme, des voies de communication. La mise à jour du plan (la conservation du cadastre) devient indispensable. Une commission extra-parlementaire chargée de l’étude des questions soulevées par la réforme du cadastre est créée en 1891. Ses travaux s’achèveront en 1905 sans avoir reçu la sanction législative. Néanmoins, leur utilité est incontestable car ils ont inspiré les travaux qui ont abouti en 1955 à la réforme de la publicité foncière et aux nouvelles règles applicables à la rénovation et à la conservation du cadastre. Enfin, la loi du 16 avril 1930 prescrit une révision exceptionnelle des évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties. Elle pose le préalable d’une rénovation générale, à la charge de l’État, des anciens plans cadastraux et de leur tenue à jour permanente. La loi de 1930 limite la réfection complète du cadastre aux seules communes où elle s’avère indispensable pour l’assiette de l’impôt foncier. Une simple mise à jour du plan est prévue dans les autres communes lorsque la valeur de la charpente de l’ancien plan cadastral est reconnue suffisante et que le parcellaire n’a pas subi trop de modifications depuis l’origine. La rénovation prescrite par cette loi est aujourd’hui terminée. Tel n’est pas encore le cas dans les départements d’Alsace et de Moselle où la rénovation du cadastre napoléonien a été entreprise en application d’une loi allemande du 31 mars 1884. Le principe de la rénovation a été repris dans le cadre de la réforme de la publicité foncière intervenue au 1er janvier 1956 rendant obligatoire la désignation des biens par leurs identifiants cadastraux dans tout acte soumis aux formalités de publicité foncière (c’est le cas notamment des actes notariés). Des liaisons étroites sont désormais instaurées entre le cadastre et le fichier immobilier tenu dans les conservations des hypothèques, qui retrace les événements juridiques de la propriété (en Alsace - Moselle c est le système du livre foncier tenu par un magistrat, hérité du droit allemand, qui est en vigueur). Enfin, une loi de 1974 autorise une nouvelle rénovation du cadastre, appelée «remaniement,» chaque fois que l’inadaptation du plan à l’évolution du tissu parcellaire le nécessite. Source : notice DGI. liens : http://perso.wanadoo.fr/cadastre |
|
Vous êtes
le Ce site est un site privé, indépendant des communes et groupements cités. |